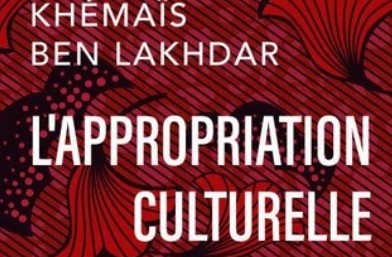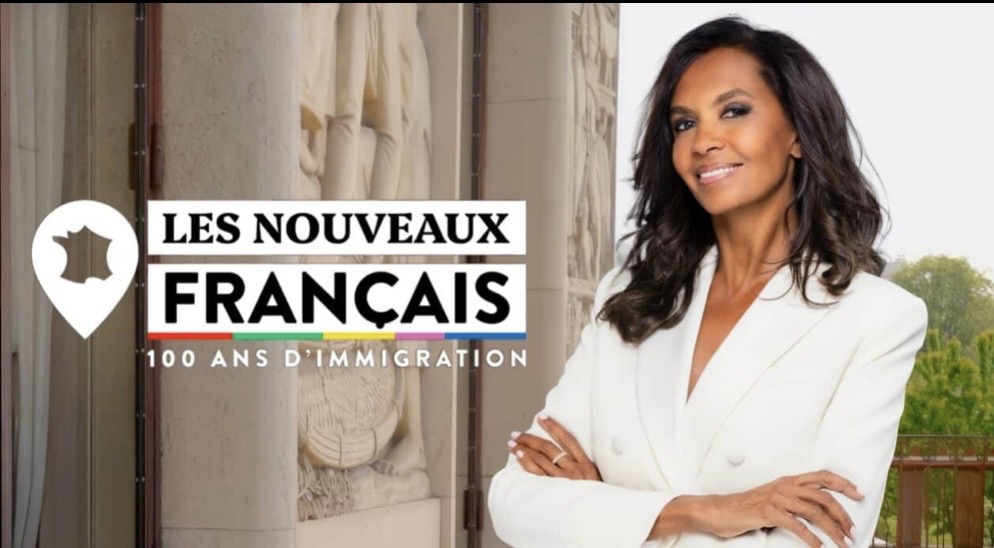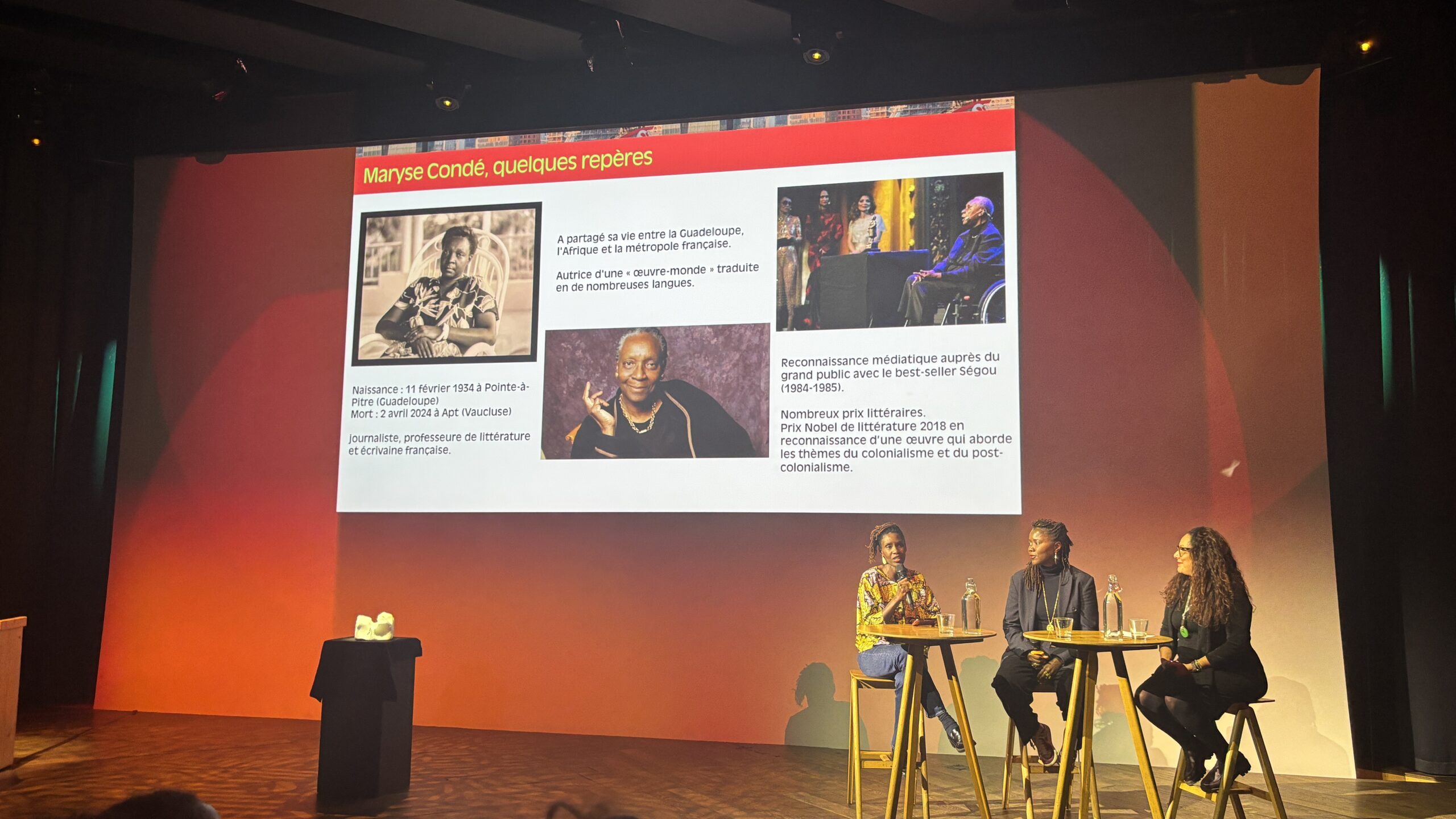Par Gabrielle Bonnet
« Appropriation culturelle », cette expression est devenue source de polémiques sans fin sur les réseaux sociaux… Face aux polémiques l’historien Khémaïs Ben Lakhdar décrypte et contextualise ce concept.
Khémaïs Ben Lakhdar est docteur en histoire, spécialiste de l’histoire de la mode. Il publie en 2024, alors qu’il prépare une thèse sur la « couture coloniale », un essai sur l’appropriation culturelle. Depuis plusieurs années, cette notion provoque des débats enflammés sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision. Tout récemment, elle est encore revenue sur le devant de la scène lors de la polémique qui a visé le designer américain Willy Chavarria, créateur des sandales « Oaxaca Slip-on » pour Adidas, directement inspirées de sandales traditionnelles d’un village mexicain de l’État de Oaxaca, sans que cette source ne soit mentionnée à aucun endroit.
Khémaïs Ben Lakhdar prend le problème à sa source, partant du constat indéniable d’une inter-influence liée au processus de mondialisation économique et culturelle. Face à ce fait, il pose alors tout simplement la question : « Quel est le problème ? ». Quel est le problème, si un créateur s’inspire de sandales mexicaines pour le compte d’une firme allemande mondialement connue ? Quel est le problème, si un homme blanc décide de porter des tresses dites « africaines » ?
Contextualiser le débat
Face à ces questions, l’auteur apporte un éclairage théorique nécessaire et pédagogique tout en ne négligeant pas sa dimension militante. Il s’agit de réintégrer le débat dans le contexte de l’histoire coloniale et postcoloniale de notre société contemporaine. Pour cela, Khémaïs Ben Lakhdar utilise la « porte d’entrée » de la mode, c’est-à-dire l’un des secteurs où la question de l’appropriation culturelle est la plus visible et la plus médiatisée.
Il évoque ainsi le développement de l’orientalisme au XIXe siècle et de l’attrait des Européens pour l’« exotisme », qui aboutira à des célébrations de l’Empire français lors des fameuses et grotesques expositions coloniales (à Paris en 1931, mais aussi déjà à Marseille en 1922). Cette passion pour un ailleurs à la fois idéalisé et assujetti se poursuit jusqu’à aujourd’hui, dans une recherche effrénée de nouvelles sources de création. L’auteur s’appuie ainsi sur de nombreux exemples tirés aussi bien de collections de haute couture que, de fast fashion.
De la tradition à la consommation
Le problème est alors celui d’une décontextualisation qui s’appuie sur une hiérarchisation et aboutit à une objectification des cultures dominées dans le contexte colonial et postcolonial. Dans ce cadre, les vêtements, coiffes ou bijoux traditionnels, transportés, transformés, détournés, sont réduits à des objets de consommation dans une logique capitaliste d’accaparement des richesses.
L’objectif (l’auteur est très clair sur ce point) n’est pas de culpabiliser le lecteur mais une fois de plus de favoriser une prise de conscience des rapports de force en jeu, ainsi que de demander une reconnaissance par les créateurs de leurs sources d’inspiration.
Pour reprendre l’image particulièrement parlante de l’intellectuelle et militante états-unienne bell hooks, la notion d’appropriation culturelle renverse la représentation raciste du sauvage : le cannibale n’est pas celui qu’on croit.