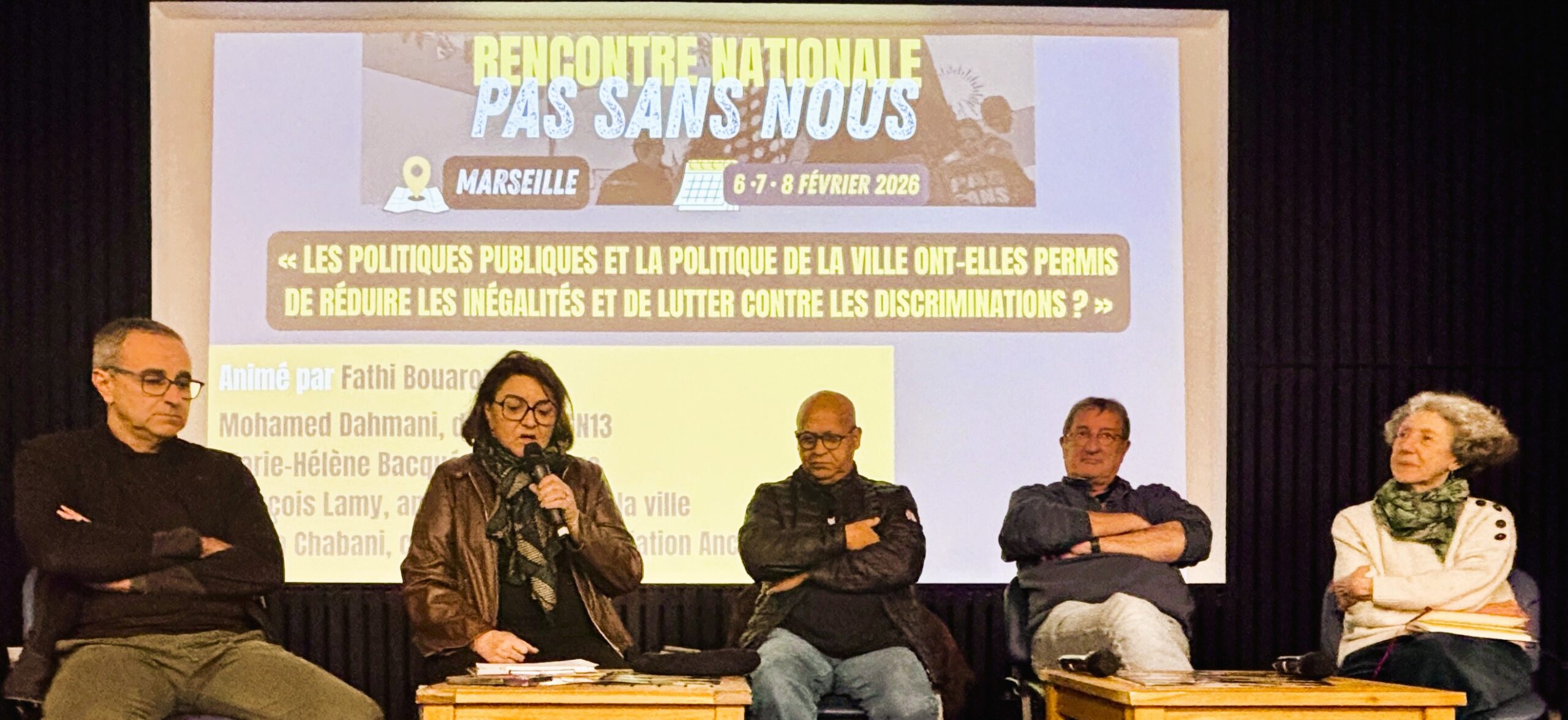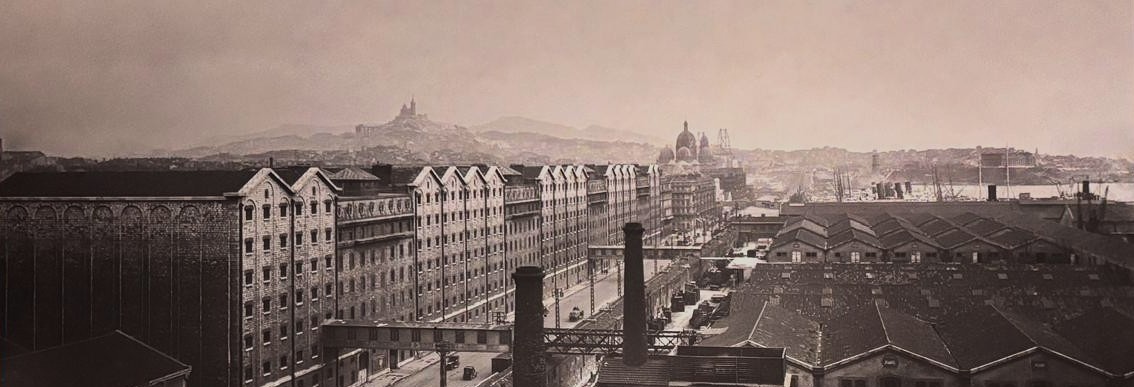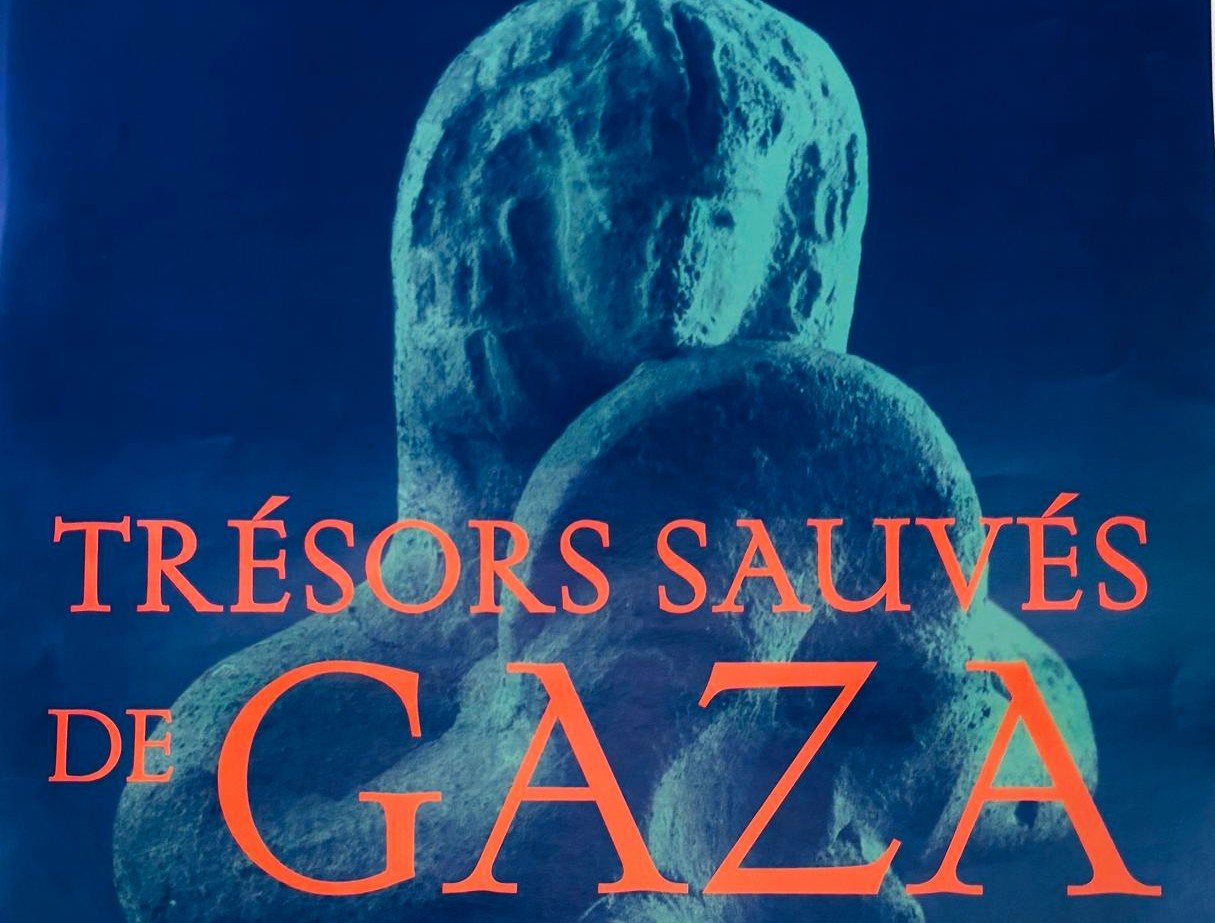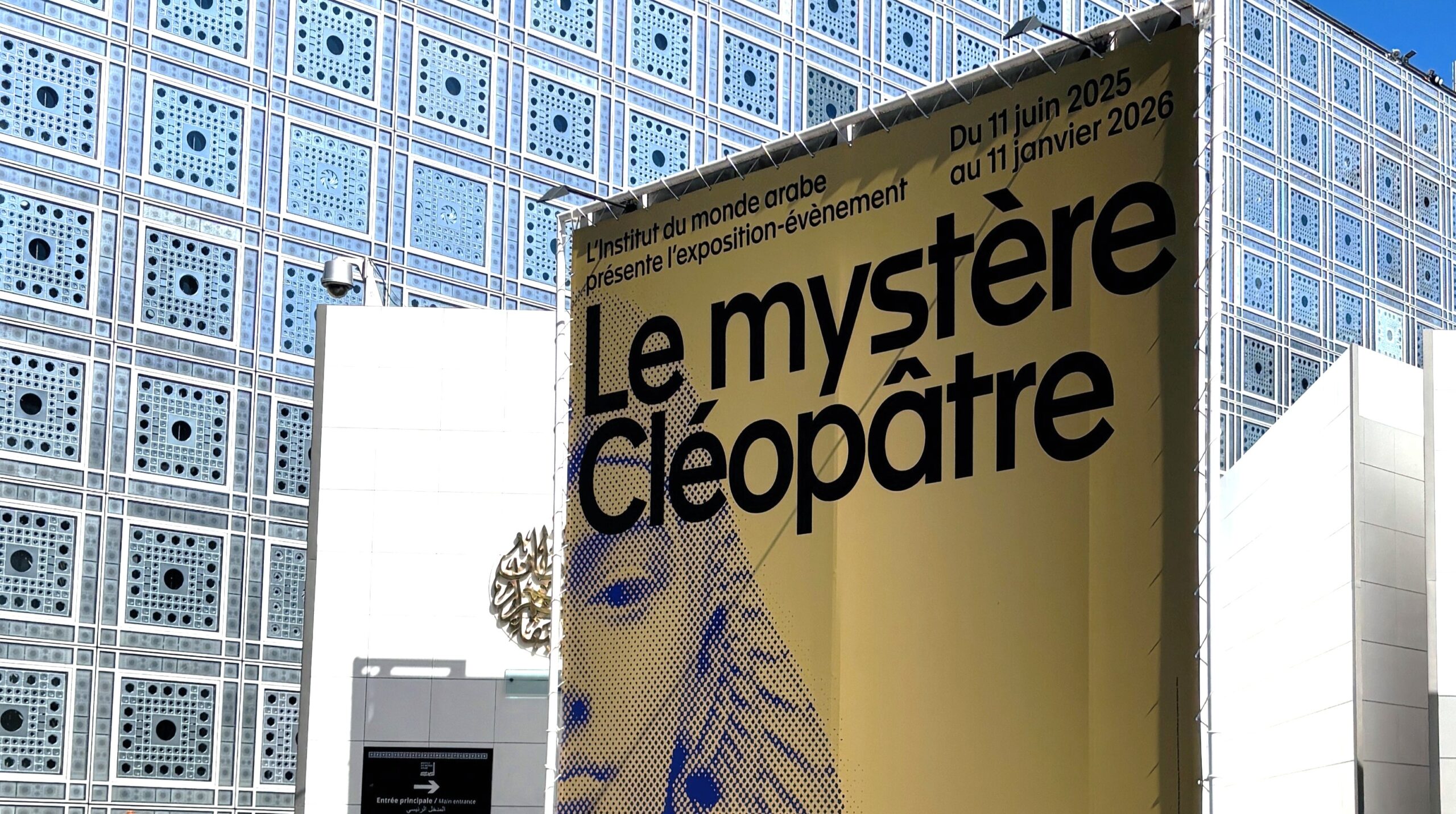Par Lilli BERTON-FOUCHET
Monsieur Bonheur : « Je n’ai pas toujours été activiste, mais j’ai toujours été révolté »
Marvin Bonheur est photographe depuis près de dix ans. Son objectif scrute les liens qui unissent les siens, interrogeant l’exclusion sociale vécue par les communautés et les territoires. Son patronyme renvoie à une grande famille antillaise, son prénom au chanteur Marvin Gaye.
Révolution 9-3
Enfant d’Aulnay-sous-Bois, il a grandi dans la cité des 3000, au cœur de la Seine–Saint-Denis. C’est là qu’il a trouvé sa matière première : une banlieue stigmatisée, caricaturée par les médias. « Toute mon enfance, j’ai ressenti ce besoin de voir quelque chose de nuancé. Ce que je voyais dans les journaux, c’était toujours du fait divers, toujours les mêmes stéréotypes. Ça a fait souffrir beaucoup de personnes issues de ces quartiers-là. Alors je me suis demandé : comment changer ça ? On ne peut pas attendre que les journalistes décident un jour de faire alliance. C’est à nous, en interne, de proposer d’autres récits. »
Au début, ses modèles doutaient : « Je ne suis pas beau/belle », « Il n’y a rien à voir ici ». Progressivement, ils ont accepté, convaincus qu’il voulait les représenter tels qu’ils sont, visages oubliés d’un territoire trop souvent réduit au cliché.
Les déracinés
Après ce premier travail, Marvin Bonheur s’attelle à une autre part de son identité : être un homme noir en France, héritier de la Martinique, terre de ses origines. Enfant, il y retournait tous les deux ans, chaque été, arpentant l’île à l’arrière d’une voiture de location. En 2017, il y réalise une seconde série, 30° à l’ombre, qui saisit la force et la culture combattante de son île, en écho à la résistance vécue en banlieue. « Moi, je suis un déraciné. Je suis martiniquais, je le sens légitimement, mais je suis un martiniquais déplacé par l’histoire et par ma famille. Et pourtant, quand je suis là-bas, je sens que c’est chez moi. »
Entre 2022 et 2023, il retourne en Martinique pour une nouvelle série : PÉYI-NOU. Cette fois, il mêle portraits et entretiens avec la jeunesse locale. Comment se construit-on aujourd’hui en Martinique ? Comment se dire martiniquais et français ? Les témoignages révèlent la violence invisible d’un héritage colonial toujours actif, les inégalités persistantes avec l’Hexagone, mais aussi l’émergence d’une génération plus prompte à se lever, en banlieue comme outre-mer. Une série qu’il souhaite prolonger en explorant la mémoire des enfants de la diaspora, privés de culture ou de langue d’origine.
Son travail s’inscrit dans une démarche de mémoire collective. Exposé au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris, dans Banlieues Chéries, il défend une conviction : « L’art peut enfermer comme il peut libérer. Décoloniser par l’art est une possibilité, tout dépend de qui le fait et comment. L’art a longtemps été rendu élitiste, difficile d’accès. Or pour moi, l’art est une arme. »
Revendiquant son rôle de « photographe de sa génération », il insiste sur l’importance de la jeunesse : « C’est à ce moment-là que naissent les problématiques de société et que s’inculquent les valeurs d’une population. »
Curieux, Marvin Bonheur a posé son regard au-delà du 93, de Londres à Detroit, de Mayotte à Shanghai. Mais Aulnay reste sa maison-mère, le socle d’un travail engagé et humain. Ses photographies, entre rage et tendresse, dévoilent les liens invisibles qui se tissent derrière chaque image : une mémoire partagée, une identité recomposée, un regard décolonial sur nos imaginaires.