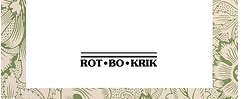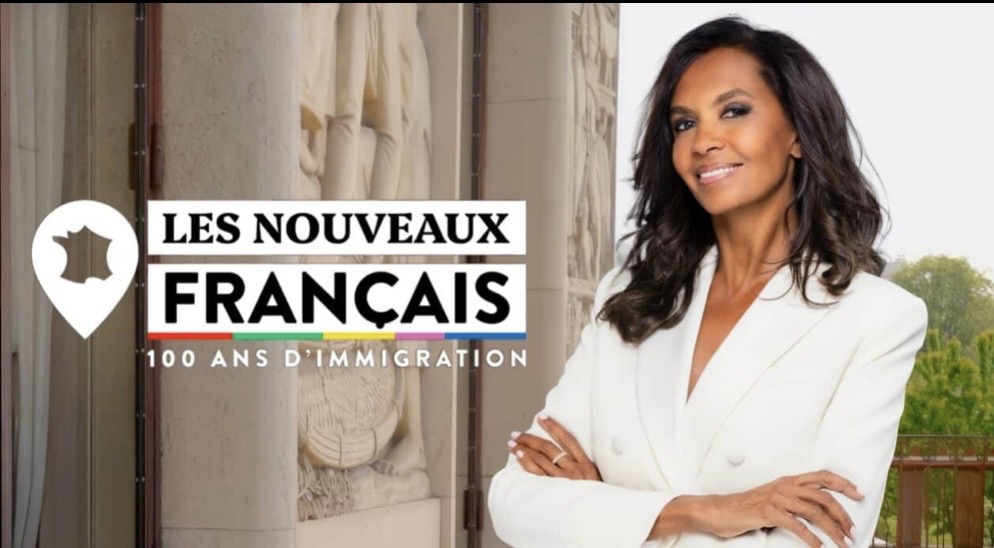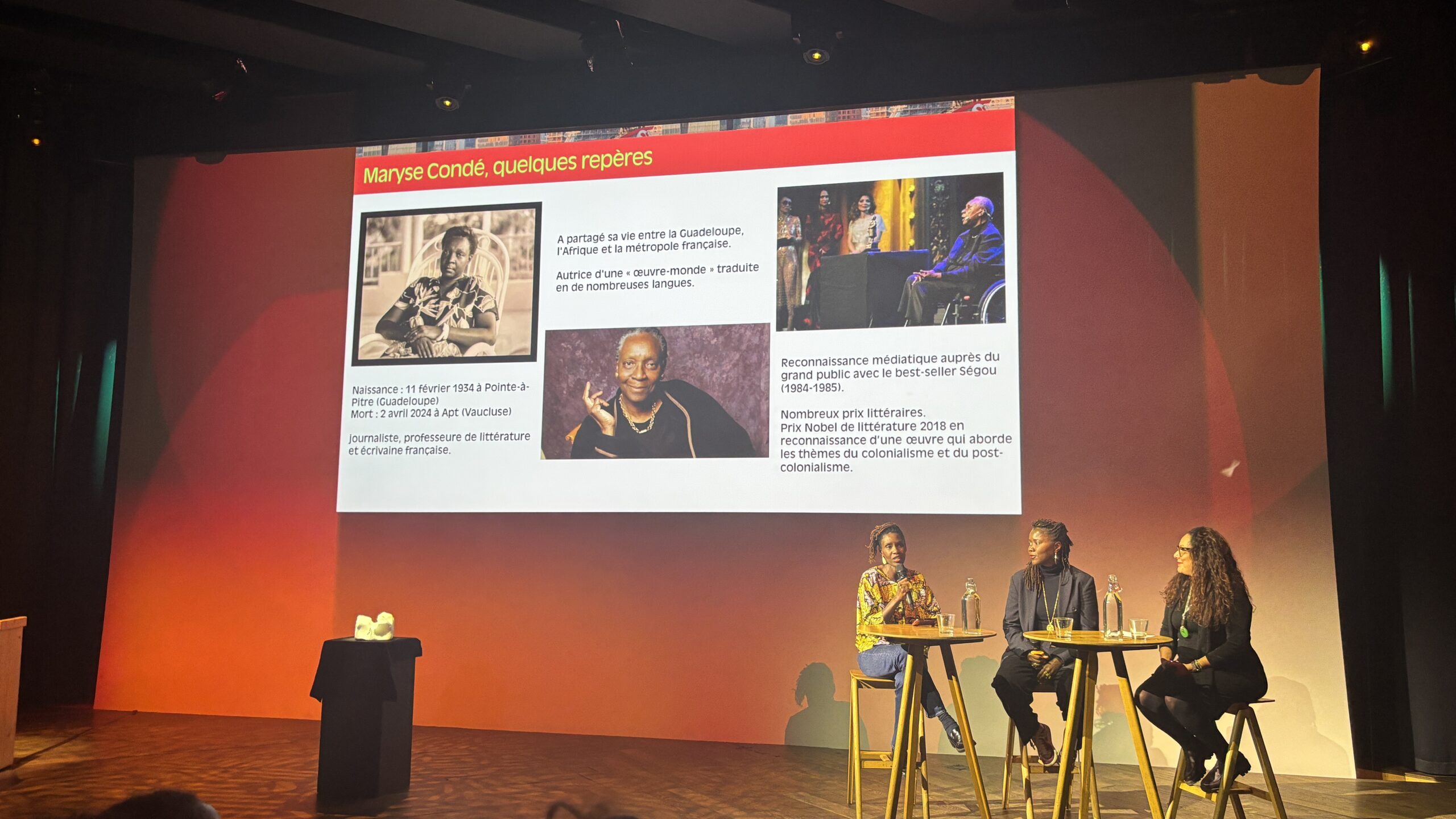Comment le nom de la maison d’édition Ròt-Bò-Krik fait-il référence à la période coloniale ?
Le nom de notre maison d’édition est une référence à la longue durée de l’histoire coloniale française. Ròt-Bò-Krik est l’ancien nom du quartier de la Crique, à Cayenne, en Guyane. Au début du 19e siècle, les autorités françaises firent creuser aux bagnards une sorte de douve pour retrancher nettement les quartiers coloniaux du reste de l’agglomération. En guyanais, Ròt-Bò-Krik signifie « l’autre côté du canal ».
Ce quartier est ainsi un extérieur à l’intérieur même de la ville et c’est là qu’ont vécu, génération après génération, les populations marginalisées. Dans les années 1970, c’est dans ce quartier que fut créée « Ròt-Bò-Krik Révolution », une revue indépendantiste qui proposait une version guyanaise de la lutte tricontinentale. Elle publiait à la fois des articles, des pamphlets, des poèmes et des nouvelles du quartier. Nous avons été inspirés par ce mélange des genres et des échelles, la façon dont une publication très locale pouvait traiter d’une situation globale, celle de l’impérialisme occidental et de ses interminables conséquences.
Nous tentons de traiter de la question coloniale, aussi vaste et structurante soit-elle, depuis un emplacement spécifique et avec les moyens du bord, puisque nous sommes une petite maison d’édition française. Ainsi, choisir ce nom, c’est rendre hommage à une aspiration anticoloniale particulière, celle de la Guyane des années 1970, et se placer dans une continuité des luttes.
Comment définissez-vous votre ligne éditoriale en lien avec les épistémologies décoloniales ?
Nous travaillons sur la question coloniale, quel que soit l’angle sous lequel on veut bien la prendre. Nous nous intéressons à l’histoire du colonialisme et de l’anticolonialisme, à la permanence de la colonialité et aux perspectives critiques décoloniales, aux sensibilités, discours, insurrections, solidarités, subjectivités, poétiques en lutte contre les logiques impériales. Sortir du monde colonial, c’est vouloir en finir avec les structures et les techniques de la domination, de l’exclusion, de la minoration, de la disqualification. Tous les domaines sont concernés, puisque c’est une domination raciale, politique, culturelle, épistémologique, spatiale, esthétique, sensorielle.
Nous considérons qu’il est nécessaire à la fois d’aller chercher des textes extérieurs à la situation depuis laquelle nous travaillons, donc des textes en traduction, mais aussi des textes qui proviennent de nos espaces, que ce soit par la commande ou par l’édition de textes plus historiques. Certains des livres que nous avons publiés sont des classiques dans les milieux anticoloniaux qui n’avaient pas encore été traduits en français, d’autres ont été écrit spécifiquement pour notre maison et donc pour notre format de livre, des ouvrages accessibles et plutôt concis, par des ami·es ou des camarades, d’autres encore nous sont arrivés par les divers réseaux intellectuels et politiques dans lesquels nous nous inscrivons.
Quel rôle attribuez-vous à la littérature, à la poésie, dans les luttes de décolonisation intellectuelle ?
Pour nous, littérature et poésie occupent une place centrale dans les luttes de décolonisation. C’est à la fois un fait historique et une dynamique que nous pensons essentielle. La liste des poètes militant·es des luttes anticoloniales est longue, mais pour un petit florilège, citons Suzanne Roussi-Césaire, Aimé Césaire, Amílcar Cabral, Déwé Gorodey, Abdellatif Laâbi, Jean Sénac, June Jordan, Mahmoud Darwich…
Comme beaucoup d’organes de presse militants à travers les âges, la revue dont nous tirons notre nom alliait dans ses pages articles de fond à caractère politique et poésie. Dans ces luttes, la littérature est source d’inspiration et de force, outil d’éducation et de formation. À chaque saison, nous publions un ouvrage de littérature aux côtés d’un essai pour souligner qu’il n’y a pas de lutte décoloniale sans imaginaire, tout comme la domination impériale passe par la soumission des imaginations.
Comment sélectionnez-vous les textes dont certains sont assez exigeants et articulent approche scientifique et appel politique?
Si la lutte anticoloniale est politique, culturelle, intellectuelle, sensible, c’est parce que tous les aspects de l’existence sociale sont concernés par la domination aussi bien que la libération. De là, ce combat est également théorique. Il passe par la nécessité de changer de perspective sur un certain nombre de savoirs et bien souvent, de ressaisir les problématiques dans le temps long de l’émancipation. Nous avons une responsabilité critique face à tous les champs de la connaissance.
Ceci étant dit, il nous semble aussi fondamental de donner à lire des textes qui soient accessibles, saisissables par des non-spécialistes, parce que le savoir ne devrait pas être un domaine réservé ou une pratique de distinction et parce que ces luttes nous concernent toutes et tous. En tant que maison d’édition, la moindre des choses est de fournir aux lectrices et aux lecteurs des livres dont ils peuvent se servir, qui aident à penser, sentir, comprendre, percevoir.
Comment affrontez-vous les logiques de marginalisation dans la distribution, la reconnaissance critique, ou les médias ?
Grâce à notre excellent diffuseur, Hobo Diffusion, qui travaille avec beaucoup de maison d’édition critiques francophones, nous sommes inscrits dans un incroyable réseau de diffusion constitué de nombreuses librairies indépendantes partout en France qui donnent accès à leur public à une grande pluralité éditoriale. Nous travaillons aussi avec toute une constellation de librairies à l’étranger qui ont des publics francophones et intéressés par les problématiques coloniales, du Cameroun au Canada, d’Haïti à la Kanaky. En outre, au-delà des médias traditionnels dont, d’ailleurs, certains s’intéressent aux questions qui nous occupent parce qu’ils comprennent qu’elles sont un enjeu important pour la société française, il existe un système de circulation de l’information, par les réseaux sociaux, les clubs de lecture, les organisations militantes, qui permet de contourner le verrouillage politique des canaux conventionnels.
Et puis le monde de l’édition indépendante francophone fait preuve d’un dynamisme qui a tout à voir avec ses logiques de solidarité. Il faut les renforcer encore pour affronter le monstre de l’édition industrielle dont la radicalisation fasciste s’accélère.
Quelle place tiennent les festivals, les partenariats dans la diffusion de votre catalogue ?
Les festivals jouent un rôle essentiel dans la diffusion et la circulation des livres. C’est un excellent moyen d’aller rencontrer notre public, existant ou potentiel. Par exemple, notre participation au FLIP (Festival du livre indépendant et politique) de Marseille nous a permis de renforcer nos liens avec les librairies de la ville, mais aussi de rencontrer de nouvelles lectrices et lecteurs, et même de potentiels autrices et auteurs.
Et puis Marseille est un lieu fondamental pour nous. Nos livres y circulent particulièrement, d’abord parce que les réseaux militants y sont très denses et actifs, mais aussi pour des raisons évidentes qui tiennent à l’histoire même de la ville. En tant que grand port colonial français, façonné par les circulations coloniales et postcoloniales, par les résistances et les solidarités populaires, Marseille occupe une place essentielle sur toutes les cartes anticoloniales, de Claude McKay à la « septième wilaya ».
Nous serons de retour cet automne à Marseille pour présenter nos nouvelles sorties, « La Grotte aux poissons aveugles » d’Ayoh Kré Duchatelet, un premier roman d’anticipation onirique centré sur l’histoire et le futur des luttes décoloniales au Congo et « Maghreb Noir », un essai de Paraska Tolan-Szkilnik sur Rabat, Alger et Tunis comme capitales de l’engagement politique et culturel panafricaniste.