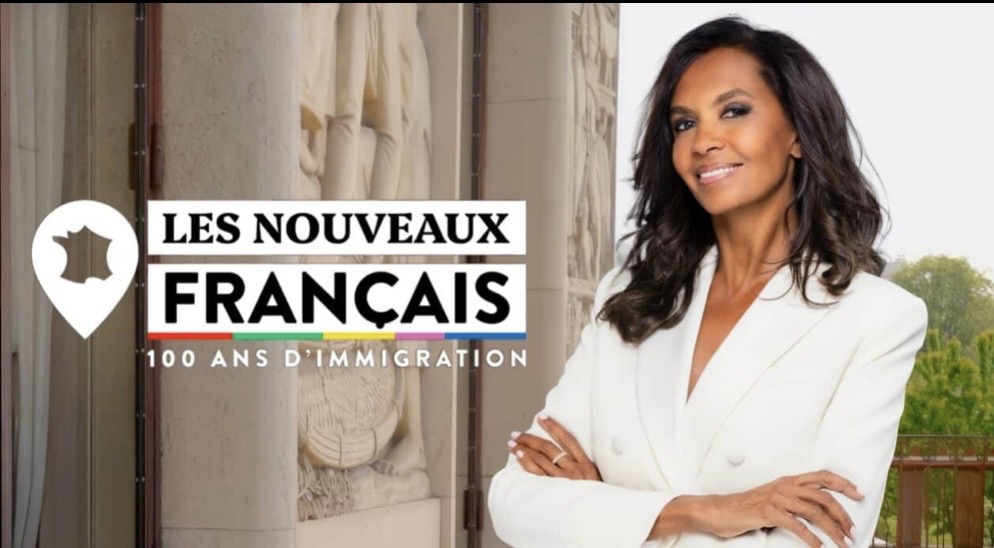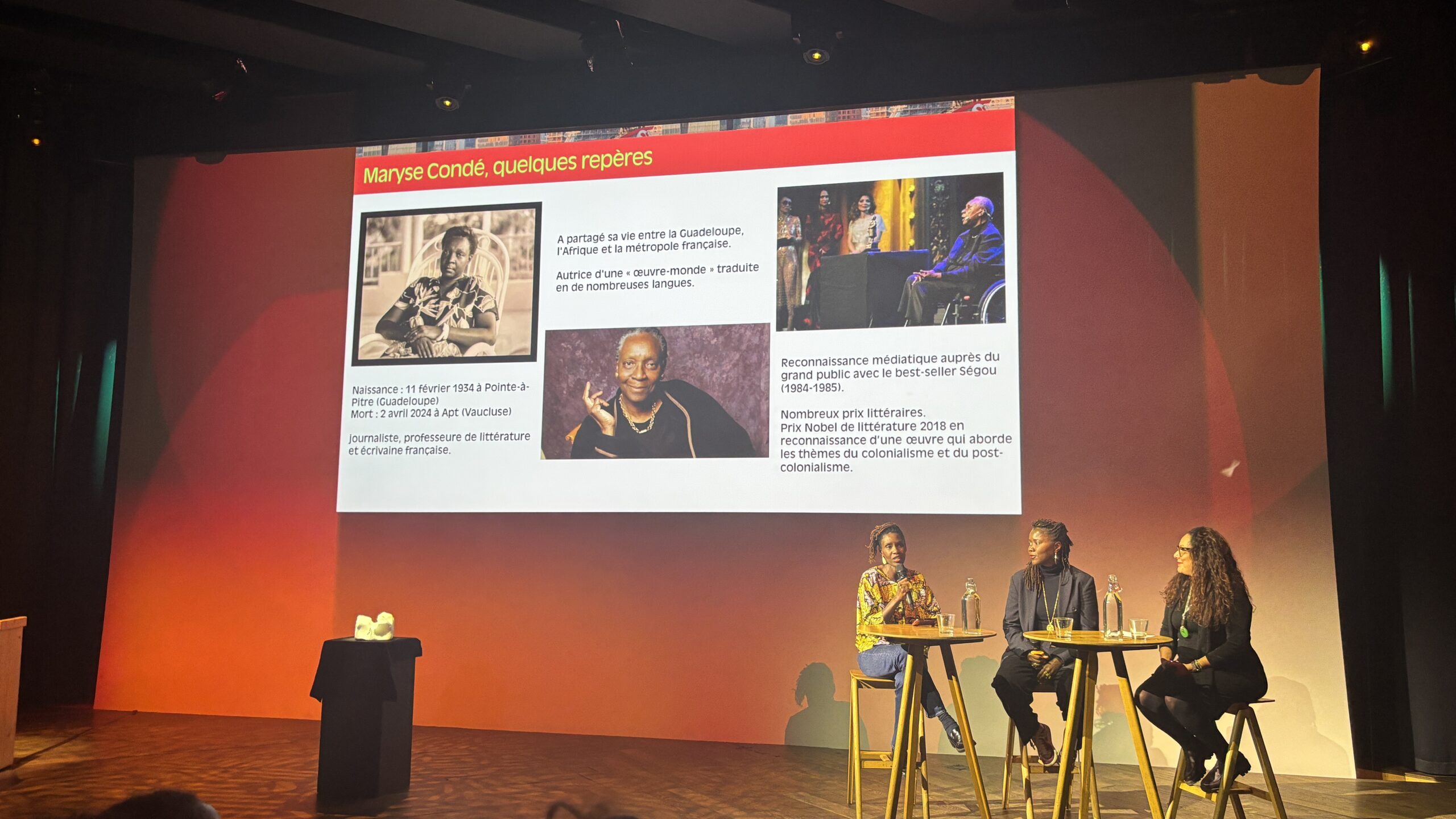Historienne et spécialiste des cultures populaires et migrantes, Françoise Vergès est l’une des figures fondatrices de l’association Décoloniser les arts. À travers son travail, elle interroge les institutions culturelles européennes, les hiérarchies coloniales qu’elles perpétuent et les manières de repenser l’art et la création dans une perspective décoloniale. Dans cet entretien, elle revient sur son engagement, les enjeux de la colonialité dans les musées et les pratiques curatoriales, et la manière dont repenser les rapports entre artistes, publics et territoires peut contribuer à un art plus juste et inclusif.
Vous avez souvent dénoncé la persistance des hiérarchies coloniales dans les institutions culturelles. Comment définir aujourd’hui « décoloniser les arts » ?
C’est l’une des sept femmes qui ont fondé l’association « Décoloniser les arts » qui avait trouvé cette appellation, et je dois dire qu’elle était très parlante à l’époque. Aujourd’hui, je parlerai plutôt de décolonisation des institutions—écoles, galeries, biennales, musées. Ces institutions font partie prenante d’une économie symbolique et matérielle loin d’être neutre. Elles appartiennent au monde européen colonial, impérialiste et capitaliste. Il y avait évidemment des collections d’art dans le monde non-européen, rois et reines, empereurs et impératrices, aristocrates, marchands ont constitué des collections, des créations artistiques étaient échangées, données, ou pillées mais l’impérialisme et le capitalisme ont changé le monde de l’art : pillages massifs, transformation de créations en « art », appropriation de pratiques, d’esthétiques, création d’une histoire de l’art où l’Europe tient la place centrale, invention du musée, organisation des créations selon des régions et des époques toutes été inventées par l’Occident. Edward Saïd a très bien montré cela dans son ouvrage L’Orientalisme. L’invention de l’Orient par l’Occident.
Aujourd’hui, je dirai que l’analyse rigoureuse de l’économie du monde de l’art révèle sa fausse neutralité. D’où vient l’argent des fondations privées : armes ? pétrole ? plantations ? Comment s’organise l’art-washing ? Comment l’art permet à des corporations et à des milliardaires de s’innocenter de leurs crimes ? Comment les musées servent à la gentrification d’une ville ? À quoi servent les politiques d’inclusion et de diversité quand les migrant.es sont harcelées, enfermé.es dans des camps ? Pourquoi la destruction totale des musées, des sites archéologiques et historiques à Gaza n’a-t-elle pas entraîné de réactions fermes des artistes ni des institutions artistiques en Occident ? Ni le pillage du musée national de Khartoum ? Il n’y a pas d’égalité entre les musées, la majorité d’entre eux est en Occident, leurs prestigieuses collections ont été fondées sur le pillage et un capital accumulé sur l’extraction. Il n’y a pas d’un côté le monde de l’art et de l’autre, le reste du monde. On a vu combien l’État français n’a pas facilité l’accueil d’artistes palestinien.nes en France, qu’il a même décidé de mettre un terme à l’arrivée d’étudiant.es palestinien.nes à la suite de dénonciations d’une étudiante par l’extrême-droite.
La décolonisation de ces institutions s’inscrit dans le large mouvement de décolonisation, elles ne peuvent pas être décolonisées seules, elles ne sont pas indépendantes des idéologies et des économies dominantes.
Dans vos écrits, vous insistez sur la manière dont la violence coloniale continue d’habiter les musées, les pratiques curatoriales, et les imaginaires artistiques. Pouvez-vous nous parler de ces formes de « colonialité résiduelle » dans l’art contemporain ?
Elles ne sont pas résiduelles, elles sont constitutives des institutions. J’observe bien sûr les efforts des musées et des biennales pour mieux donner les contextes, pour inclure des artistes du Sud global, pour initier des conversations, pour organiser des expositions sur des sujets jusqu’ici ignorés. Il était temps, et c’est justice. Maintenant, il faut aussi imposer une justice sociale—salaires et conditions de travail des personnes qui nettoient, qui gardent, des technicien.nes..—et une justice raciale dans le recrutement. Mais devons-nous continuer à demander la construction de musées sur le modèle hégémonique occidental ? Suffit-il de diversifier ce qu’il y a sur les murs et dans les collections sans remettre en cause l’économie spéculative ?
Je dois dire que je suis surtout intéressée aujourd’hui par le travail d’imagination autour de ce que seraient des pratiques curatoriales et des institutions post-racistes, post-capitalistes et post-impérialistes. Travailler à l’abolition d’un monde cruel et brutal, de dépossession et d’extraction, et de racismes, un monde dont l’économie fabrique un monde inhabitable et irrespirable pour la majorité de l’humanité et d’espèces non-humaines, c’est cet effort qui m’intéresse.
En quoi les logiques néolibérales de l’industrie culturelle entravent-elles, selon vous, toute véritable entreprise de décolonisation artistique ?
La décolonisation, ce n’est pas s’arranger avec le néolibéralisme, c’est travailler à son abolition. On vit dans ce système, et donc avec et dans les contradictions qu’il crée, mais il n’y a rien à attendre du néolibéralisme. Mais je peux dire que chaque mouvement social, chaque mouvement révolutionnaire ou de libération nationale, a mis en place des pratiques innovantes questionnant des pédagogies autoritaires, la place de l’artiste comme individu et comme génie, contestant l’art bourgeois et colonial. C’est une très riche histoire.
Comment repenser les rapports entre artistes, publics et territoires à la lumière d’une critique décoloniale ?
Peut-être en se demandant déjà comment ces rapports ont été constitués hiérarchiquement. Devenir musicien, peintre, sculptrice, performeuse, cinéaste, etc. demande de pratiquer, d’apprendre, de comprendre qu’il faut du temps, que créer est un travail à la fois mental, manuel, spirituel. L’atelier de l’artisan.e (en français, artisan.e est dévalué par rapport à artiste, c’est une division classiste) donne l’image de la transmission par l’œil, le toucher, le son, la répétition et l’autonomie. Les formes de réparation dépendent principalement de la façon dont nous rejoignons les luttes pour l’abolition du capitalisme racial, de l’impérialisme.