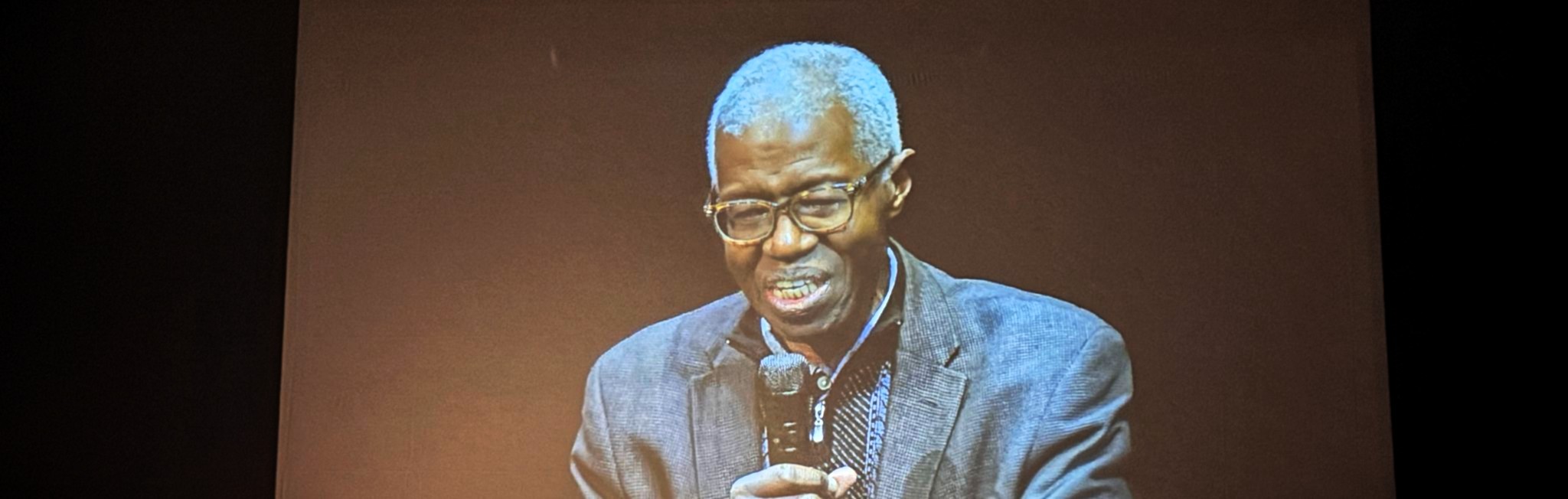Chez Maryse Condé, les chaînes se brisent, les obstacles se défoncent. Ce souffle de liberté traversait les deux hommages qui lui ont été consacrés à Marseille, ce week-end et lundi 16 février au MuCem.
Le premier, samedi, à la bibliothèque de l’Alcazar, a rassemblé écrivain·es, chercheur·es, comédien·nes et militant·es autour de celle qui, mieux que quiconque, a su dire la complexité du monde noir et la lutte pour la liberté. Organisé avec La Collective (Arles), le Comité Mam’Ega, Mamanthé, Macaya et Kadans Caraïbe, l’événement s’inscrivait dans une filiation vivante de son œuvre.
En écho, le MuCem lui dédiait un « procès du siècle » animé par Rokhaya Diallo, en présence de la cinéaste Alice Diop et l’écrivaine américaine Felisa Vergara Reynolds. Toutes deux ont rappelé combien l’autrice incarne une manière d’écrire affranchie des cadres, où la langue devient outil d’émancipation. Elle m’apprit que tout vit, tout a une âme, écrivait-elle dans Moi, Tituba sorcière…, symbole de cette croyance en une parole libératrice.
Pour Felisa Vergara Reynolds, ces deux rendez-vous soulignaient l’unité entre engagement antiraciste, féminisme et geste créatif. Car Maryse Condé n’est pas seulement une mémoire : elle reste une boussole pour nombre d’écrivaines, artistes et intellectuelles des diasporas noires. Chacune y puise la force d’être soi, sans se laisser réduire à un symbole, assigner à une langue ou à une identité. Cette vision, participe à dénoncer l’appellation « francophone » au profit d’une « littérature-monde », irriguant les débats contemporains.
Au MuCem, une œuvre de Souad El Maysour, une sculpture de sel évoquant les routes de l’esclavage prolongeait ce dialogue entre mémoire et création. Condé, elle, avait déjà creusé ces thèmes : la maternité contrariée, l’infanticide, les blessures héritées de la servitude.
Née en Guadeloupe, formée à Paris, enseignante à travers l’Afrique, Maryse Condé porta dans sa chair les espoirs et les désillusions des indépendances. Dans La vie sans fard, autobiographie sans complaisance, elle écrivait : Ma couleur, en France, devient un obstacle. Son parcours témoigne d’une foi inébranlable dans la littérature comme moyen de réinvention, de se raconter et devenir soi.
Marseille, depuis longtemps, lui rendait hommage. De sa conférence à l’Alcazar en 2012 jusqu’à sa dernière rencontre publique au MuCem en 2022, la ville fut un lieu de parole partagée entre mondes créoles, africains et européens. « Maryse Condé redonne confiance », confiait la metteuse en scène Éva Doumbia, faisant le lien entre son œuvre et celle de Maryse Condé.
Sous le regard de Richard Philcox, compagnon et traducteur, ou de Gaël Octavia et Françoise Sémiramoth, chaque témoignage a rappelé combien son œuvre, longtemps invisibilisée, imprègne aujourd’hui l’imaginaire féministe et diasporique. Cette reconnaissance, tardive, a été scellée par le Prix Nobel Alternatif de littérature en 2018.
Il n’y a pas de vérité, seulement des histoires, rappelait l’écrivain et poète amérindien Simon J. Ortiz. Dans Moi, Tituba sorcière noire de Salem à Ségou, Maryse Condé a tissé une fresque ouverte, traversée par la quête de liberté et la force du lien. C’est cette pluralité que le MuCem a célébrée, mêlant lectures et débats, évoquant aussi son amour indéfectible avec Philcox : La traduction a été notre aventure de toute une vie, disait-il.
À Marseille, la mémoire de Condé n’est pas figée : elle s’incarne dans la transmission. Les associations ont rappelé combien il importe de faire vivre son héritage auprès des jeunes générations afro-antillaises, sur scène comme dans les livres. Enfin, Aïssata Seck, directrice de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage évoque son engagement en tant quepremière présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage institué par la loi Taubira de 2001.
Deux ans après sa disparition, sa voix demeure : un appel à écrire, rêver, aimer et vivre sans fard.