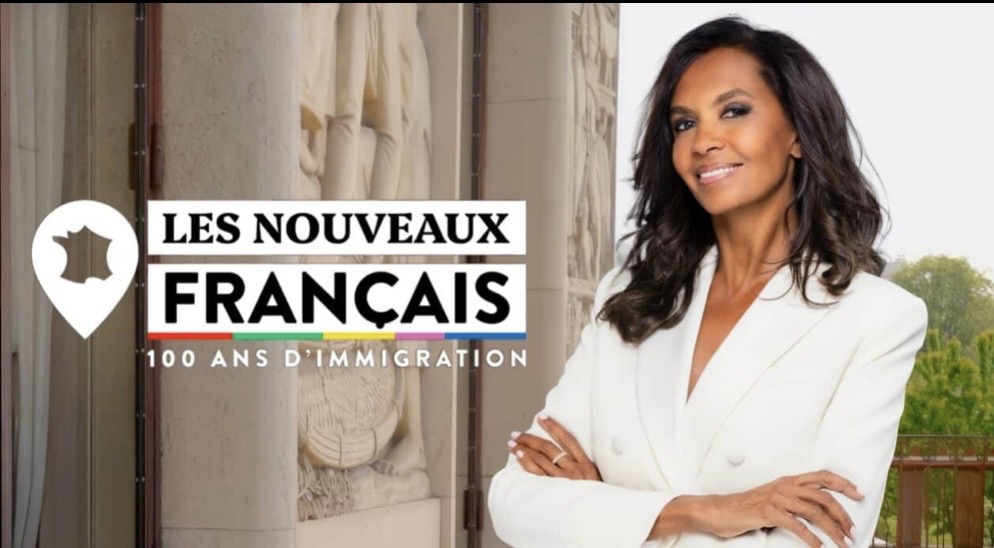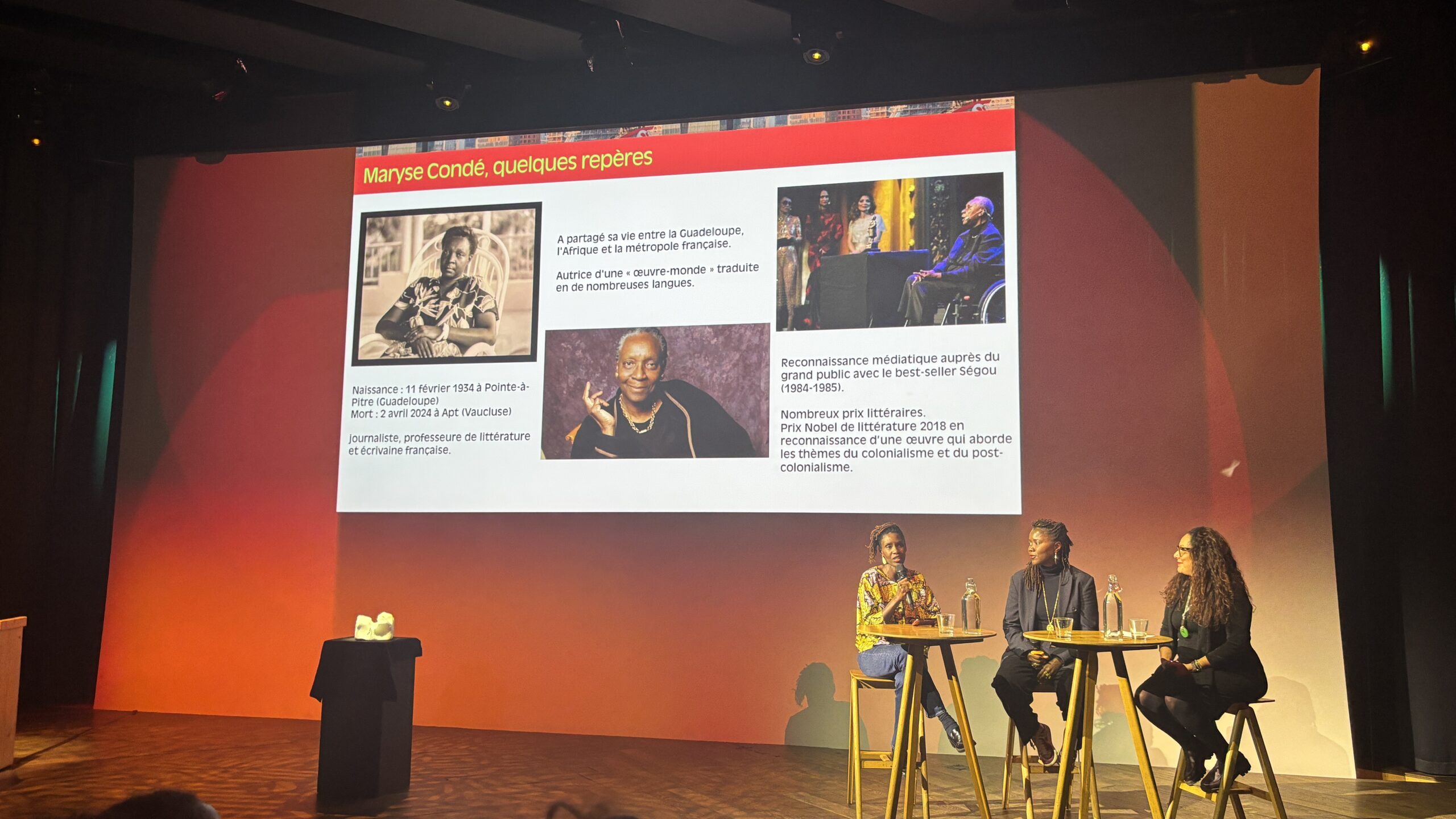Interview avec les historiens et directeurs de publication Pascal Blanchard et Nicolas Bancel.
Avec plus d’une trentaine de contributions, l’ouvrage France, terre d’immigration revient sur les relations nouées par la France avec les populations issues du monde maghrébo-oriental du début du VIIIe siècle jusqu’au premier quart finissant du XXIe siècle, pourquoi cet ouvrage aujourd’hui
Pascal Blanchard : La permanence des relations parfois conflictuelles, parfois fusionnelles, le plus souvent méconnues, que la France a nouées avec les populations de la vingtaine de pays actuels du monde arabo-oriental. La France vit, depuis 13 siècles, avec l’Orient une relation complexe et riche. Ce livre propose donc ce récit, cette longue histoire et surtout les grandes étapes de celle-ci. La cohérence de l’aire arabo-orientale et leur présence en France tient notamment à la figure centrale et mouvante de l’« Arabo-Oriental », une figure simultanément lointaine et proche, même s’il y a très peu de « Turcs » ou de « Barbaresques » en France jusqu’au XVe siècle, puis des maghrébins avec l’histoire coloniale ou des Arméniens, cette histoire traverse les siècles et se prolonge dans le présent. Cette présence a catalysé un ensemble de stéréotypes et de mythes, persistant par-delà les bouleversements historiques (coloniaux, culturels et militaires) des siècles suivants. En lien avec l’histoire concrète des rapports au sein de la France maghrébo-orientale (flux migratoires, relations diplomatiques, culturelles, militaires…), notre ambition est d’appréhender les systèmes de représentation des « Arabo-Orientaux » animés par des archétypes comme ceux du « Sarrasin », de l’« Ottoman », du « musulman », du « Levantin », du « bougnoule », du « Barbaresque », du « Sidi », de l’« Oriental », du « métèque », du « Beur » ou de l’« Arabe musulman ». Cette aire culturelle qui nous a intéressé ici occupe le pourtour méditerranéen, dont les contours et les frontières sont mouvants à travers l’histoire, s’étend des côtes de l’Atlantique à l’Iran, de la Turquie à l’Afrique du Nord, de l’Arménie à l’Égypte. Elle est cohérente, par le réseau d’interrelations tissées entre chacun des pays qui la composent, mais aussi par la simultanéité du développement des relations et des processus migratoires entretenus avec la France, de manière de plus en plus dense à partir du XIXe siècle. C’est cette histoire que raconte ce livre, à la suite d’ouvrages qui se sont inscrits dans la même dynamique depuis des années avec l’idée d’un travail collectif regroupant de nombreux spécialistes pour croisettes regards et les enjeux.
Votre ouvrage couvre une période longue et une aire culturelle qui s’étend sur une vingtaine de pays du pourtour méditerranéen, des côtes de l’Atlantique à la Turquie, de l’Afrique du Nord à l’Arménie, du Liban au Sahara, de la péninsule arabique à l’Égypte…. Pourquoi cette géographie ?
Nous avons souhaité dépasser les anciens cadastres géographiques qui séparent, habituellement, par exemple, le Maghreb du proche et Moyen-Orient. Ces divisions géographiques sont formelles et peuvent être remises en question. L’aire géographique plus vaste que nous proposons – des côtes de l ’Atlantique à l’Iran, de la Turquie à l’Afrique du Nord, de l’Arménie à l’Égypte – est cohérente historiquement. D’une part le réseau d’interrelations, parfois serrées, entre chacun des pays qui composent cette aire milite pour une approche globale. D’autre part, la simultanéité de développement des relations avec la France et des migrations vers l’hexagone des populations de ces pays – migrations qui s’intensifient dès le XIXe siècle – permettent également de soutenir cette approche spatiale. Enfin, ce livre explore à la fois les réseaux migratoires, l’implantation des populations migrantes en France, leurs activités et leurs cultures, mais aussi la construction, en France, des représentations – et plus particulièrement des stéréotypes – sur ces populations. Or, nous constatons que la figure de l’« Arabo-orientale » est dominante. Elle se décline en différents archétypes – le « Barbaresque », le « Sarrasin », l’« Ottoman », le « Levantin », et, plus proche de nous, des qualificatifs dévalorisant du « Sidi », du « Bougnoule » ou du « métèque » – qui recoupent l’aire géographique choisie pour le livre.
Pouvez-vous expliquer les ruptures et grands chapitres dans le livre ?
PB : Dans une perspective historique, et pour rendre accessible ce récit, après un long prélude de près de dix siècles jusqu’à la Révolution française et l’expédition d’Égypte nous avons articulé la période coloniale en cinq moments distincts (1798-1956) dont les guerres ont bien souvent été des césures majeures, et la période post-coloniale en cinq temps (1957-2024). Finalement, 11 chapitres structurent le livre, avec des moments de bascule comme la Révolution française, les débuts de la IIIe République et une nouvelle vague de colonisation, la Grande guerre et ensuite l’entre-deux-guerres, puis la période des Trente glorieuses, la décennie des années 70 avec la marche pour l’égalité et contre le racisme comme moment de bascule et enfin l’année 2001 puis 2014 comme les deux ruptures de la période contemporaine. Pour toutes les populations et les peuples de l’aire arabo-orientale, la France a continuellement suscité des vocations migratoires, révélant, en creux, l’attractivité d’un royaume, puis d’une nation en pleine expansion économique et dont la notoriété – en partie liée à l’alliance franco-ottomane à partir de 1536, aux échos de la Révolution de 1789 et à l’« expédition » égyptienne de 1798 – ne se dément pas jusqu’au milieu des années 1970. Les chocs des années 1973-1974 puis des années 1983-1984 marquent les premiers ressacs de cette passion. En un peu plus d’un siècle – et c’est en 1913, à Paris, que s’est réuni le premier congrès arabe –, la France semble être passée du statut de terre rêvée à celui de terre hostile, où les trois quarts des Français pensent désormais qu’il y aurait trop d’étrangers dans l’Hexagone, visant explicitement depuis plus d’une décennie les « musulmans ».
Vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire globale des migrations et où des (dé)colonisations, comment expliquez-vous qu’il n’y ai toujours pas un musée consacré à l’histoire coloniale en France?
PB : Pour qu’il y ait un musée, en France, il faut une volonté politique. Et sur la question de la colonisation (et des décolonisations), il n’y a pas de volonté politique. La question coloniale n’est toujours pas un enjeu d’histoire, et toujours un enjeu de conflit mémorial. Et ce conflit est omniprésent au sein de la société française, mais aussi dans les enjeux internationaux et la diplomatie française. En outre, pour fixer l’enjeu d’un musée il faudrait en définir le périmètre, l’objet, les contenus et la nature de l’institution. C’est bien ce qui diffère la question coloniale des enjeux muséaux concernant la période de l’esclavage ou les immigrations. Pendant une quarantaine d’années, depuis François Mitterrand, un double enjeux traverse la société française : bâtir un lieu d’hommage et de nostalgie sur la colonisation ou élaborer un lieu de critique et destiné au victime de la colonisation. Entre ces deux postures, l’espace de réflexion pour un musée spécifique fondé sur l’histoire, du patrimoine et un récit n’a pas réussi à trouver son espace d’expression, ni ses soutiens politiques.
Nicolas Bancel : Pour compléter ce que vient de dire Pascal, l’inertie politique, l’absence de volonté de construire un véritable musée consacré à l’histoire de la colonisation (et pourquoi pas ses conséquences contemporaines) tient en partie au fait que la France hérite largement de son passé colonial. En effet, plusieurs populations sont directement reliées au passé impérial : les harkis, les rapatriés (environ 800.000 pour la seule Algérie), tous ceux dont un membre de la famille a pu exercer aux colonies et, bien sûr, les immigrés issus des colonies, depuis les années 1970 majoritaires dans les flux migratoires vers la France. Or, ces populations et leurs descendants n’ont pas du tout le même regard sur le passé colonial. Par exemple, Pascal évoquait le vieux projet d’un musée nostalgique de la période coloniale, qui a été initialement porté par des associations rapatriées. Il est évident que les immigrés issus des anciennes colonies et leurs descendant n’ont pas la même vision, les mêmes souvenirs, de la période coloniale. C’est donc un sujet socialement inflammable, qui explique en partie cette inertie des politiques. Par ailleurs, la période coloniale n’est pas spécialement glorieuse, elle remet quand même fondamentalement en question les valeurs de notre démocratie républicaine, l’égalité en particulier. La colonisation remet donc en question le récit national et affronter ce bouleversement n’est pas simple. Pourtant, on sait que le passé ne peut être dépassé que lorsque l’on a admis sa réalité. Nous n’en sommes pas encore là.
Pourquoi l’articulation entre colonisation et migrations reste si peu connu alors même qu’elle est parfaitement documentée pour la France comme pour l’Empire britannique avec les ressortissants du Common Wealth?
PB : L’articulation est en fait connue et parfaitement analysée. Mais il y a un refus des effets. Des effets entre ces deux moments historiques. Comme si le statut des populations issues des immigrations en France, au regard des discriminations et du racisme colonial, ne pouvaient être aujourd’hui héritières de ce récit. Comme si la rupture des années 60 (rupture politique, géographique et institutionnelle) ne pouvait avoir de continuum. La négation est donc parfaitement pensée et surtout elle est politisée : soit elle s’impose comme une grille de lecture politique, soit elle récuse tout lien entre les deux moments historiques empêchant de facto un travail en profondeur sur les ruptures et les continuités.
Comment analysez-vous les débats décoloniaux actuels ?
Tout d’abord on peut noter l’extrême polarisation des débats publics sur ce sujet. Ces débats sont particulièrement caricaturaux, avec d’un côté un bloc totalement opposé aux perspectives décoloniales et emmené par des tribuns, que l’on retrouve par exemple dans Le Printemps républicain ou l’Observatoire du décolonialisme. Les hérauts de cette mouvance s’en prennent violemment et ad hominen à tout chercheur soupçonné d’entretenir un lien de proximité avec ces courant, ces critiques étant adossées à l’idée que celles-ci fracturent la société, brisent l’universalisme en instituant une victimisation des dominés et propagent une « haine des blancs », jusqu’à favoriser le terrorisme islamique… De l’autre, nous avons des « actions décoloniales », comme la tenue d’« ateliers non mixtes » en 2018 – autrement dit réservés aux « racisés » – organisés par le syndicat Sud, de même que dans plusieurs universités françaises depuis 2017.
Divers mouvements se réclamant peu ou prou de la mouvance décoloniale, plus ou moins radicaux, tels Les Indigènes de la République, ou encore CRAN, la Brigade anti-négrophobie ou la Ligue de défense noire africaine, qui sont à l’origine de plusieurs actions de ce type. Ils véhiculent parfois une vision militante et réductrice des études décoloniales. Ces blocs ne font que se renforcer l’un l’autre et parasitent une réflexion approfondie sur les études décoloniales. Celles-ci sont intéressantes, mais méritent évidemment un examen critique. Plusieurs ouvrages sérieux d’universitaires sont parus récemment en France, offrant des perspectives contrastées qui alimentent heureusement, à l’Université, des débats vifs mais argumentés. On peut ainsi espérer que l’on saura se saisir dans les études décoloniales ce qui a fait la fécondité de ce courant intellectuel en Amérique du Sud, sans faire l’impasse sur une critique raisonnée. Mais clairement, nous n’en sommes pas là…
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, célébrée le 21 mars, Ancrages diffuse l’exposition histoire des présences arabo-orientales à la Maison des Associations 93 La Canebière 13001 Marseille – Du lundi 17 mars au samedi 22 mars inclus.
Pascal Blanchard, historien, chercheur associé au CRHIM à l’UNIL (Lausanne), codirecteur du Groupe de recherche Achac (Paris), est spécialiste de l’histoire des immigrations en France et du « fait colonial », auteur d’une soixantaine de livre, et notamment en 2022 Histoire globale de la France coloniale (Philippe Rey) et, en 2024, Olympisme, une histoire du monde (Editions de la Martinière).
Nicolas Bancel est historien, professeur à l’Université de Lausanne, chercheur au Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation (Lausanne/UNIL) et co-directeur du Groupe de recherche Achac. Il est spécialiste d’histoire coloniale, postcoloniale et de l’histoire du corps et du sport.