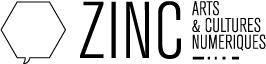Dans la cadre du projet de capsule sonore Dans ma ville, c’est l’occasion pour moi de repartir de mes souvenirs d’enfance et notamment des sons dont la réminiscence réactive les mémoires des habitants. Ce projet concrétise l’intention qui est la mienne d’écrire le récit de ma famille, son parcours migratoire et le lien avec ce quartier emblématique de l’histoire de l’immigration, des cités de transit à Marseille, Bassens.
Originaire de Mostaganem, mon père immigre en France en 1945. En réalité, il connait déjà la métropole. Il est engagé sous les drapeaux français de mars 1943 à novembre 1945. Il fait partie du 2ème Régiment de Tirailleurs Algériens. Il est l’ainé d’une fratrie d’orphelins et son engagement dans l’armée est une question de survie. Il a été « mandaté » par sa famille pour subvenir à leurs besoins. Il a pu partir, grâce à la solidarité d’un frère d’arme, camarade communiste qui lui prend en charge son billet de bateau. Suite à son licenciement des services municipaux de Cannes, il perd également son logement. De Cannes à Bassens, le changement est brutal. On débarque dans une des trois cités de transit de la cité phocéenne. A Bassens, il y avait deux pièces, une petite cour intérieure, un WC, pas de salle de bain, un lavabo mais pas de cuisine. Nous étions neuf enfants. A cette époque, nous nous sentions en « état de guerre ». Les arrestations arbitraires, les contrôles au faciès et les descentes de CRS avec leurs chiens semblent faire partie du quotidien. L’émergence dans l’espace public des jeunes issus de l’immigration, grâce à la réforme de la loi sur les associations ainsi qu’aux Marches “ contre le racisme et pour l’égalité des droits ” de 1983 a donné une visibilité aux rapports conflictuels entre jeunes et institutions.
La persistance de la tension qui suit la fin de la guerre d’Algérie, s’illustre par la répétition des crimes racistes en 1973. Cette situation conduit mon père à opter pour le retour définitif au pays, en 1974. Cette décision j’en prends connaissance une fois sur place, à l’occasion de nos vacances d’été. Elles vont durer deux ans…. J’ai 14 ans et l’école me manque. Je me sens étrangère et je ne souhaite qu’une chose, vite rentrer en France afin de retrouver mes repères. Durant cette période, je trouve refuge dans la lecture. La langue française devient mon espace de liberté et d’intimité. On utilise les pages de mes livres pour faire du feu. Je suis triste et révoltée de subir cette situation. Mais dans ce « merveilleux malheur », je développe une forme de résilience. Ce ne sera pas le cas de tous ! Nous revenons en France, en 1977, dans la même cité de transit, à Bassens. A cette période, les populations immigrées sont soumises aux politiques d’expulsion relative à l’application de la “ double peine ”. Les expulsions de jeunes “ délinquants ” étrangers sont massives jusqu’en 1981. Cette politique est vécue comme une épée de Damoclès permanente. Nos mobilisations s’unissent à celles des militants des droits de l’homme qui décident de constituer des réseaux de résistance pour soustraire quelques uns de ces jeunes à l’expulsion. Ce “ bannissement ” des enfants d’immigrés concernent majoritairement les maghrébins et en particulier les algériens. Aujourd’hui, l’exclusion sociale déclenche nombre de séparations et de décohabitations qui continuent de faire peser sur les parents, une charge écrasante. Notre société s’avère impuissante à changer le cours des choses et retourne contre eux en opprobre la violence sociale dont ils sont victimes. Un certain discours politique leur reproche “ laxisme ”, “ indifférence ” ou “ négligence ”. Rendus “ responsables ” de la perte des repères de leurs enfants, les parents de jeunes en difficulté sont aussi déclarés “ coupables ”. Le « tout sécuritaire » ambiant pousse certains élus à instrumentaliser ces questions et à brandir la menace de la privation d’aides sociales contre des familles pauvres. C’est à l’opposé de mes principes et de mes méthodes de travailleur social. Sur la Savine, quartier en cours de réhabilitation, nous bénéficions du soutien des institutions et restons attachés à la mise en œuvre de la concertation entre gestionnaire, bailleur et habitants. Notre histoire familiale est marquée par un drame. Le 03 février 1990 Philippe Vancheri assassine mon frère Hamida Benchenni, alors père de quatre enfants. Sans motif apparent, il lui tire une balle dans la tête. Plus tard, il évoque sa haine des maghrébins, des prostitués et des homosexuels. Animé par sa haine, il a fait trois victimes en une seule nuit mais l’expertise psychiatrique le déclare sain d’esprit. Le traitement de l’affaire par la presse n’a pas été objectif. J’ai vécu cela comme un double meurtre. On a sali la mémoire de mon frère. Son meurtre s’ajoute à une longue liste de crimes racistes, Lahouari Ben Mohamed en 1980, Sélim Grine en 1983 et bien d’autres…. Nous constituons les Assises des familles victimes de crimes racistes. Nous avons organisé des rencontres avec des spécialistes sur le dysfonctionnement de la justice française. Comment les meurtriers pouvaient être jugés en correctionnelle et non aux assises ? Sur cette question, nous avons bénéficié du soutien du syndicat de la magistrature. Je suis restée très sensible aux crimes racistes et je m’engage contre la clémence dont peuvent « bénéficier » les auteurs de crimes racistes et sécuritaires. La presse, de façon croissante depuis une trentaine d’années, s’est régulièrement fait l’écho de ce que la justice répugne à reconnaître la culpabilité de policiers, bénéficiant systématiquement de la présomption de “ légitime défense ”, parfois “ couverts ” par leur hiérarchie. La justice répugne plus encore à les condamner, quand bien même s’agirait-il de tabassages, ratonnades, courses poursuites, tirs mortels ou non, meurtres de caractère raciste ou sécuritaire, par des policiers en service ou hors service. Ressenties comme autant de “ permis de tuer ”, ces décisions de justice se sont enkystées dans la mémoire collective des familles de victimes, dont de nombreuses familles immigrées.
Ces évènements contribuent à me forger une personnalité en quête permanente de réponses. Réponses sociologiques, psychologiques et politiques sur les différentes formes de violence générées par notre société. Abdelmalek Sayad qualifiait les immigrés de « peuple muet ». Prendre la parole pour exprimer ma pensée devenait mon arme de combat pour moi et les miens. Mon père m’a encouragé dans cette voie, à défaut de prise de parole, c’est la violence qui s’exprime… Il avait raison.